Auteur : Gildas SAGOT (1958-2018) – Journaliste, écrivain.
Éditeur : Gallimard (Paris).
Titre : Jeux de rôle. Sous-titre : Tout savoir sur les jeux de rôle et les livres dont vous êtes le héros.
Dépôt légal : 1986. / Copyright : 1986. / Achever d’imprimer : 1986.
Pages : 161 p.
Chapitres : 1. Les jeux (11-100) – 2. Les mondes (103-142) – 3. Annexes (145-161) dont liste des clubs, liste des magazines, bibliographie.

JEUX DE RÔLE, de Gildas Sagot, est la première monographie francophone étudiant le phénomène des jeux de rôle sur table. Parue en 1986, en plein âge d’or des Livres dont vous êtes le héros (alors publiés dans la célèbre collection Folio Junior de Gallimard, aujourd’hui Gallimard jeunesse) elle semble aussi la première – et unique à ce jour – à traiter spécifiquement des livres-jeux en français. Lui même passionné de jeux, notamment Diplomacy (dont l’aspect roleplay avait largement contribué à la naissance jeu de rôle), GS était déjà l’auteur d’articles sur le sujet dans la célèbre revue spécialisée Jeux & Stratégie. Ce qui lui valut d’être abordé par Gallimard pour l’écriture de cet ouvrage, à une époque où cette activité était en pleine essor sur le marché francophone. En outre, il fut aussi l’auteur des séries Métamorphose et Défis & Sortilèges dans la collection Un livre dont vous êtes le héros.
À la demande de Gallimard, donc, GS fait le point sur cette activité ludique d’un genre nouveau d’une part en la présentant par ses différents aspects (origines, principes, inspirations, enjeux, matériel, mécanique, pratique, détracteurs…) à l’adresse du grand public, mais aussi des praticiens désireux d’en apprendre plus sur les origines de leur loisir. Néanmoins, la partie descriptive consacrée au jeu de rôle ne compte que 50 pages sur l’ensemble (p. 11-62) et si l’on ajoute les annexes, on peut dire que ce sujet en occupe un bon tiers.
En vérité, l’auteur aborde aussi plusieurs sujets connexes qui sont les livres-jeux (p. 63-77), les jeux sur micro-ordinateurs (p. 79-99) et les mondes imaginaires (p. 103 à 142). Dans cette dernière partie, GS évoque d’abord le Seigneur des Anneaux, puis les genres : la science-fiction « mythologique », le space opera et l’heroic fantasy. Ce qui donne un aperçu éloquent des catégories de jdr qui dominaient le marché à l’époque. Enfin, pour chaque genre, l’auteur a listé une série de jdr qui s’en réclament.
Globalement, l’ouvrage se présente sous une forme assez scolaire. On reprend les bases des différents sujets, puis on entre un peu dans le détail, mais pas trop. Les différentes parties se suivent religieusement, l’information est segmentée, les titres et sous-titres sont même soulignés. Par ailleurs, si le lecteur des années 80 aura pu y trouver son compte, il est possible que le rôliste moderne en apprenne bien moins. En effet, depuis lors d’autres monographies sont évidemment venues enrichir le domaine, et la magie d’Internet a favorisé la diffusion d’informations inédites et l’accès à certaines sources (ne serait-ce que par la présence sur la toile des inventeurs du genre eux-mêmes tels que Gygax). En outre, les données relatives aux clubs et aux magazines sont devenues totalement obsolètes, de même que les jdr choisis en guise d’exemples auraient besoin d’un rafraîchissement. Tout au plus, cela servirait aujourd’hui d’aperçu du tissu associatif et éditorial ludique de l’époque.
Pour autant, l’ouvrage est-il bon à jeter ? Certes non. Ne serait-ce que par la présence d’un chapitre sur les livres-jeux qui fait encore autorité en la matière, même si les sources tendent à se diversifier grâce à plusieurs e-zines et autres revues modernes tels que Alko Venturus, Le Marteau et l’Enclume et, bientôt, Architheutis. De fait, l’ouvrage témoigne d’une façon de définir le jdr propre à son époque, ce qui suffit à en faire un document intéressant.
Dans les grandes lignes, GS part du postulat qu’il est « difficile d’obtenir une définition claire et concise de cette forme de jeu qu’est le jeu de rôle (p. 16) » parce qu’il « ne ressemble à aucun autre jeu » et même « bouleverse les schémas traditionnels de fonctionnement d’un jeu ». En guise d’exemple, il évoque une dualité entre joueur et meneur de jeu, qui suivent de surcroît un objectif à la fois individuel et collectif. Bizarreries selon lui aux yeux du commun des mortels de son époque. Mais seraient-elles devenues banalités aujourd’hui ? Il me semble que l’auteur, embarrassé devant la relative complexité des éléments à traiter et sans doute emporté par la passion, ne voulait surtout pas « réduire » celle-ci à une simple définition. C’est qu’on n’enferme que très difficilement le rôliste dans une case !
Aussi pour le décrire se sent-il obligé de comparer avec le théâtre, comme si la dimension ludique du jdr ne pouvait pas inclure son aspect théâtral et qu’il fallait nécessairement le comparer à autre chose pour lui faire prendre forme dans l’imaginaire du néophyte. Paradoxalement, GS donne des pistes de définition sensées : c’est « un jeu de dialogue (p. 17) » et « le résultat d’une interaction constante entre le libre arbitre des joueurs, le hasard et la règle du jeu (p. 22) ». Cela dit, l’auteur présente plutôt bien son sujet, en tenant compte d’aspects techniques méconnus. Il reconnaît par exemple le MJ comme « un vrai animateur (p. 24) », capable de gérer un groupe d’individus.
En guise de conclusions, cet ouvrage pionnier peut encore constituer une base théorique sérieuse si l’on n’a rien d’autre sous la main, mais il permet surtout aujourd’hui de recontextualiser le jdr tel qu’on le concevait dans les années 80, notamment du point de vue de ses détracteurs. Mais si l’on souhaite connaître ce sujet sur le bout des doigts, les informations nécessitent une mise à jour sur bien des points. On appréciera la plume synthétique, allant droit à l’essentiel tout en tenant compte des détails. On notera aussi sa volonté de dédiaboliser le jdr en référence aux « levées de boucliers (p. 61) » du BADD (Bothered against Dungeons & Dragons), association américaine se disant « inquiétée par Donjons & Dragons ». Car il le fait posément, sans se lamenter ni tirer en longueur.
Lors du prochain Laboratoire de Ludologie, nous verrons comment cette tentative de définition va prendre forme au fil des années, et si le jeu de rôle est ou pas définissable > Dossier Définir le JdR article n°2 : 1997 : criminologie du jeu de rôle (Jean-Hugues Matelly).
Les mots-clefs de Gildas Sagot : Alchimie – Aventure – Fabulation – Langage – Dialogue – Table – Groupe – Division – Interaction – Règle – Hasard.
Bibliographie : SAGOT, Gildas. Jeux de rôle : tout savoir sur les jeux de rôle et les livres dont vous êtes le héros. Paris : Gallimard, 1986, 161 p.
Webgraphie : La Bibliothèque des Aventuriers.

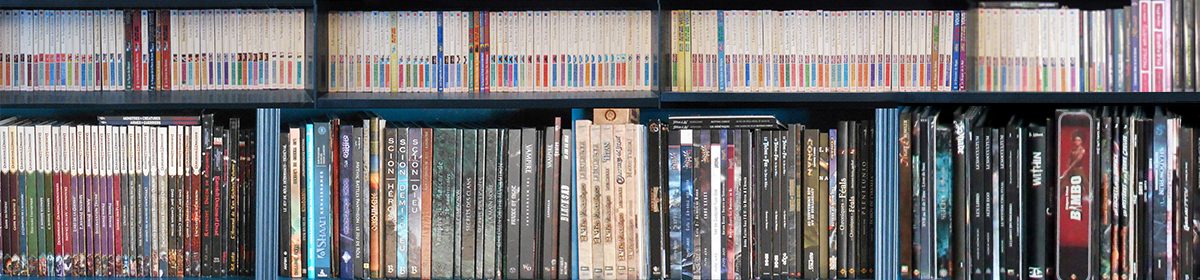
2 réflexions sur « 1986 : l’ouvrage pionnier »